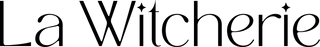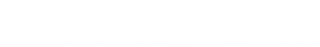Une origine païenne : Litha et le solstice d’été
Bien avant l’ère chrétienne, les peuples d’Europe célébraient le solstice d’été, la journée la plus longue de l’année, sous le nom de Litha. Cette fête païenne marquait l’apogée de la lumière solaire et honorait le Soleil à son zénith.
Les célébrations de Litha comprenaient :
-
l’allumage de grands feux de joie pour symboliser la lumière et la purification ;
-
des danses communautaires autour des flammes ;
-
des rituels de fertilité, de protection et d’abondance ;
-
la cueillette d’herbes médicinales, considérées comme particulièrement puissantes en cette période ;
-
un lien profond avec la magie naturelle et la connexion à la Terre.
C’était un moment de célébration de la lumière, mais aussi de conscience du basculement à venir : dès le lendemain, les jours commenceraient à raccourcir. Ce point d’équilibre entre lumière et ténèbres faisait de Litha un rite de passage important dans la Roue de l’année païenne.

Vers 350 ap. J.-C. : récupération chrétienne de Litha
Dans sa stratégie d’évangélisation, l’Église catholique a souvent intégré des fêtes païennes à son calendrier. Vers le IVe siècle, elle récupère les célébrations du solstice d’été et les associe à Jean le Baptiste, le cousin de Jésus. Selon les Évangiles, Jean serait né six mois avant Jésus, dont la naissance est célébrée au solstice d’hiver (Noël).
Cette association symbolique permet à l’Église d’unir : le feu du solstice d’été (hérité de Litha) ; et l’eau du baptême (symbolisée par Jean).
Les feux deviennent ainsi des rituels de purification chrétienne, et les rassemblements païens sont remplacés par des processions religieuses, des messes et des chants liturgiques.
1608 à 1834 : la Saint-Jean arrive en Nouvelle-France
Importée par les colons français, la Saint-Jean-Baptiste est célébrée dès les débuts de la Nouvelle-France (fondée en 1608). D’abord fête religieuse, elle s’installe dans le calendrier chrétien et conserve certains éléments populaires comme les feux de joie.
Mais c’est au XIXe siècle qu’elle prend un tout nouveau sens.
24 juin 1834 : la Saint-Jean devient fête nationale du peuple canadien-français
Le 24 juin 1834, Ludger Duvernay, journaliste et patriote, organise à Montréal un grand banquet de la Saint-Jean pour affirmer l’unité culturelle des Canadiens français. Inspiré par les célébrations nationales d’autres peuples, il fait de la Saint-Jean un symbole identitaire.
À partir de ce moment, la fête prend une tournure politique. Elle se démarque de sa seule fonction religieuse et devient un rassemblement patriotique où se mêlent banquets, messes, processions, et défilés.
9 juin 1843 : fondation de l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal
Afin d’organiser les célébrations annuelles de manière structurée, l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal est fondée le 9 juin 1843, toujours sous l’impulsion de Ludger Duvernay. Le premier défilé officiel de la Saint-Jean a lieu cette même année.
24 juin 1880 : première interprétation de « Ô Canada »
Lors des festivités de la Saint-Jean à Québec en 1880, un nouveau chant patriotique est interprété pour la première fois : « Ô Canada ». Ce chant deviendra l’hymne national du Canada un siècle plus tard, en 1980.
24 juin 1925 : jour férié officiel au Québec
La Saint-Jean-Baptiste devient un jour férié au Québec en 1925, confirmant son importance culturelle et sociale dans la province.
24 juin 1977 : la Saint-Jean devient la Fête nationale du Québec
Sous le gouvernement de René Lévesque, le 24 juin est proclamé Fête nationale du Québec. Cette décision marque un détachement officiel de l’aspect religieux de la Saint-Jean pour affirmer son caractère culturel, identitaire et laïque.
Années 1980-1990 : une fête marquée par la politique
Dans le contexte des référendums de 1980 et 1995 sur la souveraineté du Québec, la Fête nationale prend une tournure très politisée. Elle devient un lieu d’expression pour les aspirations nationalistes, mais aussi un espace de réflexion collective sur l’avenir du Québec.
Aujourd’hui : une fête rassembleuse aux racines profondes
Aujourd’hui, la Fête nationale du Québec est un moment de célébration culturelle, d’expression artistique et de rassemblement populaire. Elle intègre progressivement une reconnaissance des cultures autochtones et des communautés diverses qui composent le Québec moderne.
Chaque année, le 21 juin, lors de la Journée nationale des peuples autochtones, se tient le Solstice des Nations, où des cérémonies traditionnelles ont lieu. Les braises du Feu de l’Amitié, allumées à cette occasion, servent à enflammer le grand feu de la Fête nationale sur les Plaines d’Abraham le soir du 23 juin, bouclant ainsi le cycle ancestral entre feu, peuple et Terre.
De Litha à la Fête nationale, la tradition des feux du solstice a traversé les siècles, transformée, récupérée, réinterprétée. Ce feu sacré, qui célébrait autrefois la puissance du Soleil, brûle toujours — aujourd’hui comme symbole d’un peuple, d’une culture et d’un héritage vivant.